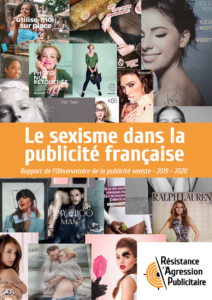 Injonctions à la beauté, à la minceur, à la jeunesse, sexualisation pour les femmes, performance pour les hommes… Le rapport de Résistance à l’Agression Publicitaire révèle un archaïsme sexiste persistant.
Injonctions à la beauté, à la minceur, à la jeunesse, sexualisation pour les femmes, performance pour les hommes… Le rapport de Résistance à l’Agression Publicitaire révèle un archaïsme sexiste persistant.
Bouche entrouverte, décolleté, pose suggestive mais aussi sottes qui ne savent pas conduire ou injonction à porter la charge mentale du foyer, la pub distille des messages qui empêchent le sexisme ambiant de s’éteindre. L’association française, Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP) qui veut « lutter contre les effets négatifs, directs et indirects, des activités publicitaires sur les citoyens et l’environnement » a mis en place en 2019 l’Observatoire de la Publicité Sexiste. Un formulaire mis en ligne du 25 mars 2019 au 25 mars 2020 permettait à toute personne qui le souhaitait de signaler une publicité qu’elle aurait vue et jugée sexiste, en expliquant pourquoi.
165 contributions ont été reçues par RAP et elles contredisent bien des messages autosatisfaits du monde de la pub qui prétend, dans un récent rapport, que les annonces sexistes sont des « pubs qu’on ne verra plus jamais ». Ou encore affirme dans l’Obs que les hommes seraient devenus le « sexe faible de la publicité ». Faux. Au contraire, selon RAP, la diffusion de stéréotypes et d’injonctions sexistes persiste en France, et s’est même renforcée « que ce soit par l’usage de vieux clichés, l’invention de nouveaux procédés de marketing, ou encore la récupération des luttes féministes. »
L’analyse des 165 annonces publicitaires le montre implacablement : le premier ressort du publisexisme est la sexualisation des corps féminins. La position du corps, bouche entrouverte ou jambe écartée, renvoie à différentes positions sexuelles dans une pub pour un parfum. La panoplie standard de vêtements sexy, décolleté, la robe ou la jupe courte se trouvent dans bien des publicités qui ne vendent pas ces vêtements sexy. Le cadrage et le vocabulaire sont bourrés de connotations pornographiques.
Sans surprise, 81% des publicités dénoncées par l’Observatoire visent le genre féminin. Les secteurs les plus représentés sont ceux de l’habillement-parfumerie et de l’hygiène-produits de beauté qui représentent plus de la moitié de ces publicités. Le plus souvent, articulées autour de stéréotypes mettant en scène des rôles genrés ou réduisant la femme à la fonction d’objet.
Le rapport dresse une liste non-exhaustive d’injonctions. L’injonction à la beauté : « Sois belle avant tout » reste un ressort sexiste incontournable. Dans la mode et la beauté, les produits, pour beaucoup a priori unisexes, sont promus pour et par des femmes, renforçant l’idée de la femme superficielle et de l’homme intelligent et profond. L’injonction à la jeunesse : « Sois jeune pour être belle » qui va de pair avec la beauté, car bien entendu, il faut être jeune pour être désirable. Même la pratique du sport impose des règles différentes aux femmes et aux hommes. Un club sportif parle de “Summerbody” pour les femmes – en rose forcément-, et focalise sur la performance pour les hommes, avec l’objectif “42 km” en bleu.

Autre stéréotype récurrent : « Les femmes ne savent pas conduire », ce qui en plus d’être sexiste, renvoie au fait que les femmes sont reléguées au rang de suiveuses et que les hommes doivent « prendre le volant » et donc être les décideurs principaux.
Le rapport dénonce les effets de ces publicités. D’abord le renforcement de la culture du viol. Des chercheurs ont montré que la représentation médiatique des femmes comme victimes renforçait l’acceptabilité sociale de la violence à leur encontre. Le stéréotype de la femme sexualisée produit à la fois une injonction envers les femmes, mais aussi envers les hommes de les considérer comme des objets sexuels à leur disposition.
Effet sur les comportements alimentaires aussi. La diffusion permanente de ces images dans l’espace public tend à instaurer une norme du corps féminin. Un corps jeune, mince, sexualisé. Le rapport parle de normativité publicitaire qui rend tous les autres corps différents anormaux. Des recherches ont mis en avant le lien entre la diffusion massive d’images de corps féminins aux attraits pour beaucoup inatteignables et la progression des troubles obsessionnels compulsifs et troubles alimentaires chez les femmes. 90% des personnes souffrant d’anorexie mentale sont des femmes.
Et il est toujours difficile d’échapper à ces injonctions publicitaires : le mode de diffusion le plus représenté dans l’échantillon est l’affichage extérieur, à 86%. Un mode de publicité qui s’impose aux passant.es.
RAP dénonce l’inefficacité de la régulation de la publicité en France. Le contrôle est fait par des instances d’autorégulation composées de professionnels de l’industrie qui ne voient pas le problème du sexisme. Ceux qui prétendent que les choses ont changé et que la tendance s’est inversée. En outre, ces instances n’ont aucun pouvoir d’interdiction et ne peuvent émettre que de simples avis. Le RAP appelle à une régulation par des instances indépendantes. Il appelle purement et simplement à l’interdiction de l’utilisation des corps dans la publicité.
Lire aussi dans Les Nouvelles News
LA PUB SEXISTE NE FAIT PAS VENDRE
UN PACTE POUR QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE NE SOIT PAS BÊTISE SEXISTE RÉELLE
PENDANT LA CRISE LA PUB CONTINUE. SEXISTE…


